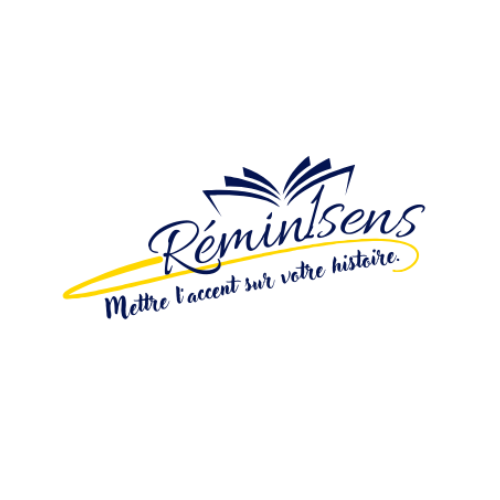Ils en parlent

Dernière mise à jour février 2025
Retrouvez dans cette rubrique les dernières actualités qui renforcent notre mission, publiées par des sources telles que le Figaro, l'OMS etc...
Des protéines de la solitude visibles dans le sang
Publié le 29 janvier 2025 par le Figaro santé
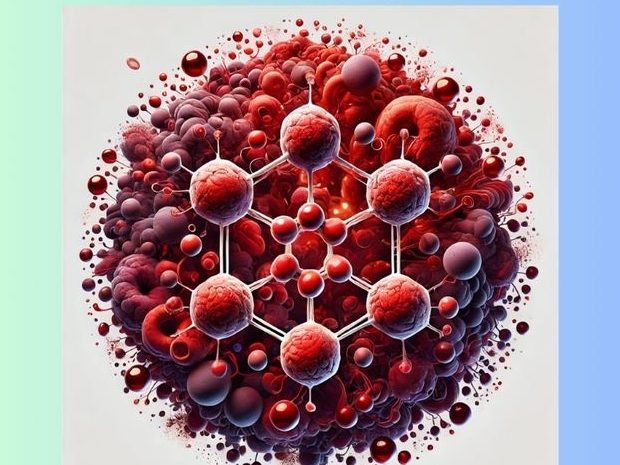
Des protéines associées à l’isolement social et à la solitude ont été découvertes par des chercheurs.
L’hypothèse évolutionniste
« Ces résultats édifiants nous rappellent qu’il existe des supports biologiques à la solitude », commente le Dr Guillaume Fond, psychiatre et auteur de Bien nourrir son cerveau contre le stress, la dépression, le déclin cognitif (Odile Jacob). Il explique que les liens entre solitude et inflammation avaient déjà été décrits, avec une hypothèse évolutionniste. « Les populations qui présentent ces comportements d’isolement social seraient plus performantes face aux risques de transmission des infections, les individus infectés s’isolant “spontanément” du groupe, une sorte de biologie prophylactique », affirme-t-il. En clair, les protéines de l’inflammation sont peut-être la cause de l’isolement, et non sa conséquence.
Quoi qu’il en soit, ces résultats soulignent l’importance des contacts sociaux pour notre santé. Malheureusement, l’Organisation mondiale de la santé a décrit l’isolement social et la solitude comme un « problème de santé publique mondial ». « Force est de constater que la solitude est de plus en plus forte et contrairement aux idées reçues, elle est également très présente chez les jeunes en particulier depuis le Covid, la précarité et la fragmentation sociale induite par les écrans », constate le Dr Guillaume Fond. C’est le paradoxe : dans un monde hyperconnecté, une personne âgée sur quatre souffrirait d’isolement et entre 5 et 15 % des adolescents éprouveraient de la solitude. « Mais les interventions de santé publique luttant efficacement contre l’isolement social et la solitude se font attendre... » conclut le Dr Guillaume Fond.
On sait aujourd’hui que les personnes les plus engagées socialement ont globalement une meilleure santé. À l’inverse, ne pas avoir d’amis ni de relations sociales, ou se sentir seul, augmente le risque d’être malade et de mourir prématurément. Les effets néfastes de l’isolement social et de la solitude sont même comparables à ceux d’autres facteurs de risque bien connus comme le tabagisme, l’obésité et l’inactivité physique, rappelle l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). Cependant, les mécanismes biologiques en jeu ne sont toujours pas connus. C’est ce qu’ont cherché à élucider des chercheurs de l’université de Cambridge (Royaume-Uni) et de l’université de Fudan (Chine).
Inflammation chronique
Or, ces protéines associées à la solitude et à l’isolement social sont également connues pour être impliquées dans l’inflammation ainsi que dans les réponses antivirales et immunitaires. « Par exemple, en cas d’isolement social ils constatent une augmentation de la protéine GDF15. Cette protéine anti-inflammatoire est libérée par les cellules, dont celles du cœur, en réponse à un stress. C’est donc un marqueur d’une inflammation à bas bruit », explique le Pr Bernard Sablonnière, chercheur en neurobiologie et auteur du livre Les mystères du corps humain (Odile Jacob). Or l’inflammation chronique fait le lit de nombreuses maladies, cardiovasculaires notamment.
L’étude suggère également que la solitude peut conduire à une augmentation des niveaux de cinq protéines spécifiques. L’une des protéines qui semble être produite en plus grande quantité en cas de solitude est l’adrénoméduline, qui joue un rôle dans la régulation des hormones de stress, ou des hormones sociales telles que l’ocytocine. « En renforçant l’ocytocine, l’adrénoméduline renforce le comportement empathique. Cela signifie que le cerveau réagit pour lutter contre cette solitude. Mais le problème c’est que lorsque le taux d’adrénoméduline augmente, on constate un risque accru d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiaques ou encore de démences », souligne le Pr Bernard Sablonnière. Dans l’étude, les taux augmentés d’adrénoméduline étaient ainsi liés à un risque accru de décès précoces. Une autre protéine associée à la solitude est ASGR1, qui est également liée à un taux de cholestérol plus élevé et à un risque accru de maladie cardiovasculaire.
Mais comment?
Pour cela ils ont d’abord suivi plus de 40 000 adultes anglais sur une période de douze ans en moyenne. Dans cette cohorte, il y avait à peu près 9 % de personnes isolées socialement et 6 % d’entre elles souffraient de solitude. L’isolement social est une mesure objective basée, par exemple, sur le fait qu’une personne vive seule, sur la fréquence de ses contacts avec d’autres personnes et sur sa participation à des activités sociales. La solitude, en revanche, est une mesure subjective basée sur le fait qu’une personne se sente seule. Les chercheurs ont ensuite analysé les protéines présentes dans des échantillons de sang collectés auprès des participants. Les scientifiques ont ainsi identifié 175 protéines associées à l’isolement social et 26 associées à la solitude (environ 85 % de ces protéines étant à la fois associées à l’isolement et à la solitude), rapportaient-ils début janvier dans la revue Nature Human Behaviour.
©Droits d'auteur. Tous droits réservés.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.